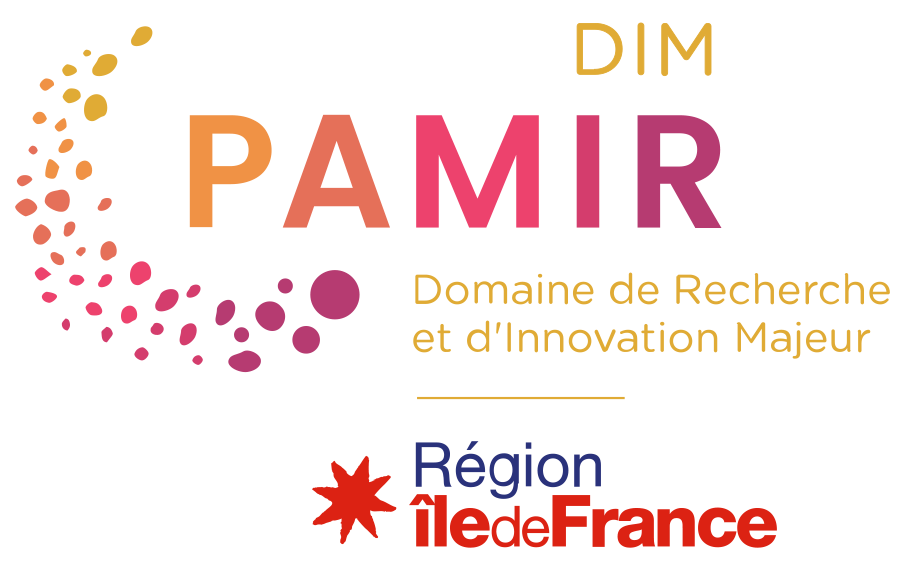Valentina Valbi, projet Brume
Valentina Valbi, pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours et sur votre activité principale aujourd’hui ?
Mon parcours a commencé par une licence à l’université de Bologne, sur le campus de Ravenne, en Sciences et techniques pour les matériaux du patrimoine. Le programme couvrait un spectre assez large, de la chimie à la biologie, en passant par la physique des matériaux et même l’histoire de l’art. C’est pendant ces études que j’ai commencé à travailler sur les matériaux du patrimoine comme des pigments et des dorures. Ensuite, j’ai suivi un master de chimie à Bologne avec spécialisation en chimie analytique. Grâce au programme Erasmus, je suis venue étudier à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP). Mon stage de master 2, à l’ENSCP et au Centre de recherche et de restauration des musées de France, portait sur l’altération en milieu atmosphérique des émaux de Limoges. J’ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine du verre du patrimoine et les problématiques d’altération qui s’y rapportent. Mes superviseurs m’ont ensuite fait savoir qu’une thèse était proposée à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et me voici doctorante à l’UPEM. Je travaille actuellement en Allemagne à l’université de Postdam pendant trois mois. Ce n’était pas prévu au départ, mais il m’a semblé intéressant de faire l’expérience de la mobilité.
Vous êtes impliquée dans le projet Brume. Pouvez-vous décrire brièvement le projet et son contexte ?
Brume est l’acronyme de Brunissement des vitraux médiévaux. A la surface de certains vitraux médiévaux, on peut voir apparaître des taches brunes, riches en manganèse. Ces tâches sont difficiles à caractériser chimiquement parce qu’elles ne sont pas très cristallisées. De plus, il s’agit d’un matériau très sensible : il peut rapidement s’altérer par photoréduction, ne serait-ce que durant le temps de son étude. Ma thèse porte sur la compréhension et la modélisation de ces phénomènes de brunissement, que je m’attache à reproduire en laboratoire. Je dois d’abord comprendre comment et quand le manganèse migre dans le verre puis percer le mystère de la formation de la phase brune. Est-ce une oxydation en surface ou une précipitation ? Pourquoi le manganèse se concentre-t-il à un endroit précis ? Ce phénomène est-il d’origine biotique ?
Durant votre thèse, vous manipulez de nombreuses techniques, dont de la culture de bactéries !
Oui en effet, et je n’ai pourtant pas de formation en microbiologie, j’apprends sur le terrain. Au LGE, il y a déjà des études biotiques et abiotiques en cours. C’est intéressant parce qu’on trouve beaucoup de travaux dans la littérature qui font le lien entre ce phénomène lié à la présence de manganèse et l’altération microbiologique. Tout cela reste à découvrir.
Vous avez participé à la Fête de la science 2019 en animant le stand du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux sur le Village des sciences de Sorbonne Université. A quoi se mesure votre intérêt pour la diffusion de la culture scientifique ?
Quand je dis autour de moi que je fais une thèse en chimie, on me répond « Oh ce doit être très dur ! » mais quand j’explique un peu plus mon travail, on le situe déjà beaucoup mieux. L’avantage d’un sujet comme le mien c’est qu’il est concret et visuel. Tout le monde se figure ce que sont les vitraux, et des taches brunes en surface… La diffusion de la culture scientifique, la transmission de nos recherches, est aussi un enjeu particulier dans le domaine des sciences appliquées au patrimoine et aux matériaux anciens, car ce n’est pas un champ très connu du « grand public ». Je suis très sensible à cette question, je m’intéresse aux différentes façons de communiquer sur mes recherches en particulier. J’ai suivi une formation avec les petits débrouillards et j’ai appris comment animer de manière amusante un jeu de questions-réponses.

Une anecdote insolite sur votre projet à nous raconter ?
Le plus mémorable reste l’expérience sur site. Quand il faut prélever sur des vitraux des échantillons microbiologiques, cela doit se faire dans un environnement très contrôlé. Mais quand on est perché sur des échafaudages, avec un casque et un gros manteau en plein mois de novembre… c’est une expérience qui marque ! C’est aussi une chance unique d’examiner des vitraux médiévaux à 10 cm de distance à peine.
Quelles sont les actions qui vous intéressent le plus dans le DIM ? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du réseau ?
Avant tout, ce sont les aspects relatifs à la formation, comme ils ont été abordés notamment lors de l’atelier DOPAMINE[1]. Le DIM ouvre aussi des voies intéressantes à la valorisation et la diffusion des recherches. Par exemple, quand j’ai entendu parler de l’appel à projet Film scientifique pendant la journée dédiée aux jeunes scientifiques, cela a attiré mon attention. Nous avons répondu à l’appel en proposant le projet de film animé VisA Brume[2], qui a été soutenu. Depuis, notre équipe travaille avec Big Bang Science Communication sur ce projet. C’est très appréciable d’avoir cette opportunité grâce au DIM.
[2] Le projet VisA Brume – Visualisation Animée du Brunissement des Vitraux Médiévaux – est un projet de film scientifique, qui a été soutenu par le DIM fin 2018 (CRC-LRMH, LISA, LGE, Cité du Vitrail de Troyes, Big Bang Science Communication). Le film réalisé, accessible au « grand public », explique l’objet des recherches menées dans le cadre du projet Brume. Il aborde la thématique d’interaction entre les matériaux du patrimoine et l’environnement, en montrant la démarche scientifique suivie et l’apport des recherches sur les matériaux du patrimoine aux problématiques de conservation patrimoniale.
Stéphanie Duchêne, projet RamPArC
Stéphanie Duchêne, vous travaillez au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) en tant qu’assistante ingénieure, spécialisée dans l’étude des matériaux des peintures murales et des phénomènes d’altération. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours et sur votre activité principale aujourd’hui ?

J’ai suivi un parcours en chimie appliquée à la conservation et la restauration à l’université de Venise. Puis j’ai travaillé en tant que chargée d’études au Consiglio Nazionale delle Ricerche sur la caractérisation des peintures murales et de chevalet, et peinture sur métal. Enfin, je suis entrée en 2007 au LRMH au pôle Peinture murale et polychromie. Dans ce pôle, nous travaillons sur deux types d’activités. D’une part, nous menons des études de caractérisation et de diagnostic sur des peintures murales et polychromies à l’occasion de chantiers de restauration, ou d’études préalables à ces chantiers. Et d’autre part, nous nous attaquons à des problèmes ouverts particuliers en matière de conservation-restauration. Par exemple, dans une étude en cours, nous cherchons les moyens de consolider des peintures murales sur des structures maçonnées gorgées d’eau et de sels solubles. Pour l’instant, les conservateurs et les restaurateurs sont démunis face à ce genre de problèmes et ne disposent pas de solutions satisfaisantes à long terme. L’enseignement et la valorisation de nos activités constituent un troisième axe fort au Laboratoire. Nous intervenons dans différentes institutions comme par exemple l’Ecole de Chaillot pour la formation des architectes du patrimoine ou l’Institut National du Patrimoine (INP) auprès des élèves conservateurs et restaurateurs.
Vous portez le projet d’équipement RamPArC [ʁɑ̃.paʁ], cofinancé par le DIM, et qui consiste en l’acquisition d’un instrument portable de spectroscopie Raman pour l’étude du Patrimoine Artistique et Culturel. Pouvez-vous décrire l’idée à l’origine du projet et son contexte ?
La spécialité du LRMH, c’est de se déplacer sur les sites classés monuments historiques. Nous avons un pool d’instrumentation de terrain que nous augmentons depuis une dizaine d’années pour accroître nos capacités de caractérisation in situ. Mais nous ne sommes que la moitié du temps sur le terrain, et l’autre moitié au Laboratoire. Donc ces instrumentations ont un taux d’occupation partiel. L’idée de ce projet est de mutualiser les moyens, dont les instruments in situ font partie, afin d’en diversifier les usages. C’est aussi un moyen de formaliser nos collaborations avec nos partenaires, notamment la Bibliothèque nationale de France et l’Institut national du patrimoine. Nous mutualisons aussi nos connaissances. Il est intéressant de croiser les expertises, qui portent sur les mêmes matériaux mais qui diffèrent par leur mise en œuvre. C’est également l’occasion de réfléchir à la constitution d’une base de données des matériaux de référence car, pour l’instant, on crée une base de données ad hoc pour chaque nouvel équipement de spectroscopie que l’on acquiert. Les contributions au projet peuvent être très diverses, il peut entre autres s’agir d’encadrer des stagiaires qui nous aideront à constituer cette base.
Qu’avez-vous commencé à mettre en place avec vos partenaires autour de RamPArC ?
Comme nous n’avons pas encore reçu l’instrumentation, nous allons commencer en septembre à travailler à la constitution de la base de données de matériaux de référence. D’ailleurs, à l’occasion du séjour de Laurent Romary dans le cadre du projet DOPAMINE[1], nous avons passé une étape importante dans la réflexion sur la gestion des données, leur pérennisation et leur archivage. Nous avions déjà commencé à y réfléchir, mais aujourd’hui nous avons besoin d’experts dans ce domaine pour nous aider à commencer de la façon la plus structurée et réfléchie en amont, ce qui devrait assurer la pérennité et la robustesse de notre système propre de gestion de données et de ressources. Et en participant aux ateliers DOPAMINE, nous avons pu échanger sur nos pratiques et sur les problématiques de traçage et de réutilisation de données. C’est très stimulant de se poser les mêmes questions que d’autres équipes de recherche et de rencontrer des experts.
Vous annoncez un très riche programme de valorisation pour le projet RamPArc. Vous envisagez notamment d’utiliser cet appareillage dans le cadre de la formation initiale des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (INP) et d’intervenir auprès du grand public. Ces objectifs sont-ils toujours d’actualité ? Où en êtes-vous ?
Oui, c’est toujours d’actualité. Ma collègue Sophie Cersoy, maître de conférences au Centre de Recherche sur la Conservation, prévoit de faire des démonstrations d’instruments à la Fête de la Science au Muséum national d’histoire naturelle. Nous ferons des démonstrations et présenterons les activités du Laboratoire lors des Journées du patrimoine. Avec Maroussia Duranton de l’INP, nous travaillons pour que l’équipement soit utilisé par les étudiants restaurateurs en 5e année, dans le cadre de leurs projets de fin d’études. L’équipement pourra également servir à la préparation d’une exposition à la Bibliothèque nationale sur le site Richelieu.
Quelles sont les actions qui vous intéressent le plus dans le DIM ? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du réseau ?
Ce que le réseau permet de faire, c’est augmenter notre niveau d’expertise. Rencontrer des équipes de recherche avec qui on pourrait envisager de collaborer, et des experts qui seraient intéressés par nos applications pour améliorer les leurs. À partir des échanges et des collaborations qui se créent, on valorise très concrètement ce que l’on fait. On a tout à gagner à travailler et réfléchir ensemble.
Christophe Moreau, projet PatriC14
Christophe Moreau est physicien au Laboratoire de Mesure du Carbone 14, spécialisé dans la datation d’échantillons à faible teneur en carbone. Il est le porteur du projet PatriC14, lauréat d’un appel à projet d’équipement du DIM, et grâce auquel il va repousser les limites de la datation d’échantillons rares…
Nous lui avons rendu visite au CEA de Saclay, dans les locaux du laboratoire LMC14, pour qu’il nous présente l’équipement phare au cœur du projet PatriC14.
Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? Quelle est votre activité principale au LMC14 ?
Je suis physicien nucléaire, spécialisé en datation au radiocarbone. Je travaille sur la plateforme nationale LMC14, le Laboratoire de Mesure du Carbone 14. Je suis un des anciens directeurs du laboratoire et je dirige aujourd’hui l’une des trois équipes du LMC14, celle qui travaille sur la spectrométrie de masse par accélérateur, auprès de la machine ARTEMIS. J’ai aussi d’autres activités : je suis responsable de l’analyse de données au laboratoire et je m’occupe aussi des développements techniques autour d’ARTEMIS. Mais le cœur de mon travail est de trouver des moyens de dater des échantillons avec une très grande précision, en ne prélevant qu’une infime quantité de matière de l’objet à analyser, pour ne pas le détériorer.
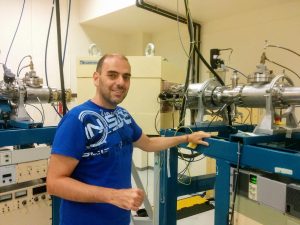
Comment fait-on pour dater un échantillon ?
Nous utilisons un accélérateur de particules couplé à un spectromètre de masse. Le peu de matière à analyser est pulvérisée et transformée en faisceau d’ions. Ceux-ci sont ensuite accélérés et envoyés dans le spectromètre de masse. Le spectromètre sert à compter combien il reste de carbone radioactif dans l’échantillon, c’est-à-dire quelle quantité de ce carbone ne s’est pas encore désintégrée. Donc moins il en reste, plus l’échantillon est vieux. On sait dater des échantillons sur une période allant du présent à 45 000 ans en arrière.
Et PatriC14 dans tout ça ? Quelle est l’idée au centre du projet et comment est-elle née ?
L’idée est née des travaux de recherche que nous menons au laboratoire et dont la finalité est de réduire autant que possible la quantité de carbone nécessaire à une datation. On veut rendre datables des objets qui ne le sont pas aujourd’hui à cause de leur très faible teneur en carbone. Le projet PatriC14 porte sur l’amélioration de notre outil d’analyse, ARTEMIS. Plus précisément, le financement du DIM va permettre de modifier l’une des deux sources d’ions existantes, pour y mesurer des échantillons sous forme gazeuse. Cela signifie moins de préparation chimique, car il n’y a pas d’étape de réduction et donc moins de contamination potentielle de l’échantillon, pouvant fausser la datation. L’autre avantage à pouvoir analyser des échantillons à très faible teneur en carbone, c’est que l’on doit prélever moins de matière. Et c’est un point critique quand on veut travailler avec des échantillons précieux.
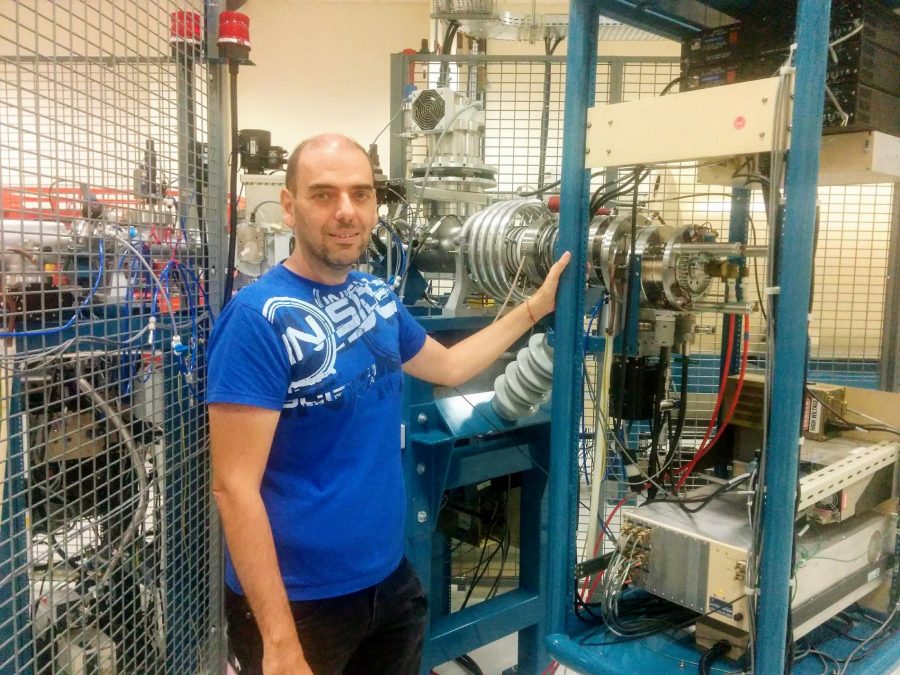
Pour terminer, quelles sont vos attentes vis-à-vis du réseau ?
Faire partie d’un DIM pour une mise en contact au niveau régional et travailler en réseau, ce sont des atouts essentiels. Au départ, on ne savait pas ce que ce réseau devait être. Mais dès la journée de lancement, on a vu toutes les potentialités d’applications, et on a senti clairement l’envie de tout le monde de s’impliquer. Cela n’existe pas au CNRS ou CEA sous la même forme « inter-organisme ». Aujourd’hui, il y a un volet qui m’intéresse vivement, c’est l’accès et la valorisation des données. Échanger les données va créer des liens entre des personnes qui ne se connaissent pas. Bien sûr, il faudra aborder la question des droits. L’idéal serait de créer une plateforme de partage de données. Je souhaiterais volontiers intégrer le groupe de travail sur ce sujet si un tel projet se montait. Il y a E-RIHS aussi… De façon générale, le DIM est à plusieurs égards une première pierre pour une structure plus grande.
Laurent Romary, projet DOPAMINE
Laurent, vous êtes directeur de recherche à Inria, ancien directeur de l’infrastructure DARIAH et président de l’ISO/TC 37, un comité technique de l’Organisation internationale de normalisation. Quel est votre parcours et quelle est aujourd’hui votre activité principale ?
 Je suis informaticien, ingénieur à Supélec à l’origine. Puis j’ai fait ma thèse sur un sujet à mi-chemin entre informatique et linguistique. Je suis entré au CNRS en tant que chercheur puis je suis devenu directeur de recherche Inria. J’ai coordonné des recherches portant sur des thématiques à l’interface entre linguistique et informatique : dialogue homme-machine, traitement automatique des langues, analyse de documents. J’ai beaucoup travaillé sur la représentation des données, qui est l’un des thèmes centraux de ce que l’on appelle aujourd’hui les « humanités numériques ». Petit à petit, j’ai pris des responsabilités dans le champ de la standardisation et des infrastructures numériques pour les sciences humaines.
Je suis informaticien, ingénieur à Supélec à l’origine. Puis j’ai fait ma thèse sur un sujet à mi-chemin entre informatique et linguistique. Je suis entré au CNRS en tant que chercheur puis je suis devenu directeur de recherche Inria. J’ai coordonné des recherches portant sur des thématiques à l’interface entre linguistique et informatique : dialogue homme-machine, traitement automatique des langues, analyse de documents. J’ai beaucoup travaillé sur la représentation des données, qui est l’un des thèmes centraux de ce que l’on appelle aujourd’hui les « humanités numériques ». Petit à petit, j’ai pris des responsabilités dans le champ de la standardisation et des infrastructures numériques pour les sciences humaines.
Pouvez-vous décrire brièvement le projet DOPAMINE, qui a été soutenu par le DIM ?
L’objectif du projet DOPAMINE est de faire état de la part d’attention accordée, au sein du DIM, à la production, la gestion et la diffusion des données numériques. J’ai rencontré beaucoup de partenaires différents aux pratiques très variées, notamment des doctorants et post-doctorants financés par le DIM, mais aussi des responsables d’équipements. L’idée est de dresser un premier diagnostic que je transmettrai au réseau.
Comment l’idée au centre du projet DOPAMINE est-elle née ?
Elle est née de l’interaction au niveau européen entre l’infrastructure DARIAH – que je dirigeais jusqu’au 31 août dernier – et la mise en place de l’infrastructure E-RIHS pour les sciences du patrimoine. Il s’agissait de voir comment DARIAH pouvait contribuer à la dimension numérique d’E‑RIHS, en particulier en termes de gestion de données. Et en interagissant plus particulièrement avec les collègues du laboratoire IPANEMA, il nous est apparu nécessaire de faire remonter les besoins précis des utilisateurs, en étudiant les cas concrets des projets portés par des institutions membres d’E-RIHS, plutôt que d’imposer d’emblée un plan général européen. Cette mission m’a permis de mieux cerner ce que recouvrait l’étude des matériaux anciens, par exemple l’analyse physico-chimique des matériaux du patrimoine. Cela a facilité le dialogue avec les différents partenaires du DIM.
Vous avez proposé et animé plusieurs ateliers au sein réseau. Quel en est le premier bilan ?
Le bilan est… intéressant ! Ce qui me frappe le plus, c’est que la dimension numérique est très peu considérée dans la plupart des projets de recherche. J’ai pu me rendre compte par exemple que les doctorants, qui manipulent de l’information numérique dans le cadre de leur projet de thèse, ne disposent pas toujours de l’outillage et des méthodes correspondantes pour la gestion de ces données. Tous les aspects de documentation des données ou des logiciels, d’utilisation des standards et d’environnement d’hébergement, sont en dehors de leur « radar ». Et on observe une situation similaire au niveau des institutions. En la matière, tout ou presque reste à faire !
Une anecdote insolite sur votre projet à nous raconter ?
Si je devais en choisir une, ce serait celle-ci : lors de l’atelier DOPAMINE à l’adresse des jeunes scientifiques, je leur ai demandé combien d’entre eux documentent les données qu’ils exportent depuis leurs manips. Grand silence… Puis un petit doigt timide se lève : « moi je mets des mots-clés en haut de mes colonnes dans un tableur ». C’est un exemple typique du risque que nous prenons à ne pas former très tôt nos chercheurs aux bonnes pratiques de gestion des données.
Que veut dire valorisation pour vous et en particulier dans le cadre du projet DOPAMINE ?
Il existe bien des façons de valoriser la recherche. Pour ce qui est du projet DOPAMINE, je pense que la transversalité inhérente au projet en fait une proposition qui peut être utile à tous. Le rapport que je délivrerai à l’issue du projet pourra aboutir à une forme de valorisation au service du DIM, et je l’espère, une contribution à une future feuille de route numérique pour E-RIHS au niveau européen.
Votre activité future dans le DIM : avez-vous des projets avec d’autres membres du réseau ?
Oui, j’ai établi de nombreux contacts avec différentes institutions membres du réseau. Par exemple, nous avons commencé à réfléchir avec le Laboratoire de recherche des monuments historiques, au moyen d’accompagner les équipements récemment cofinancés par le DIM d‘une véritable stratégie numérique, comprenant un environnement normalisé pour la gestion des projets d’accès, le déploiement d’un carnet de laboratoire numérique pour tracer la production et la transformation des jeux de données, ou encore l’identification de solutions d’hébergement. Avec le C2RMF aussi, nous envisageons de travailler à une proposition pratique d’amélioration de la gestion des données. J’espère pouvoir poursuivre ces collaborations avec de telles institutions.
Plus généralement, quelles sont vos attentes vis-à-vis du réseau ?
Rester en contact. Cette mission m’intéresse beaucoup et je souhaite pouvoir la continuer, sous une forme ou sous une autre. Je ne couperai pas les ponts dès mon départ !
Renaud Chabrier, NOVA PISTA
Renaud Chabrier est réalisateur, expert en transmission scientifique par l’image, le récit et le dessin. Il a par ailleurs entamé une thèse sur le dessin et les sciences du vivant. Il est l’un des associés de Nova Pista, société associative de production audiovisuelle et entreprise partenaire du DIM.
Nous lui avons rendu visite dans son bureau à l’Institut Curie, sur le campus d’Orsay.
Qu’est-ce que c’est qu’un expert en transmission scientifique ?
Sur l’étagère, Renaud Chabrier prend un gros volume. C’est dans cet ouvrage d’Alfred Korzybski – Science and Sanity[i], sur le rôle de la science dans la société des années 1930 – qu’il a trouvé un terme propre à mieux définir son activité : la notion de transmission. Transmettre une information fiable d’une génération à une autre est même une dimension essentielle de l’activité scientifique.
 Pour notre hôte aujourd’hui, c’est en effet une expression plus satisfaisante pour décrire son travail que ne le sont communication, vulgarisation ou même médiation scientifique, car à ces différents termes sont souvent associés des types de publics et des motivations toutes autres. Instruire ? Divertir ? Vendre ?… Pour Renaud Chabrier, ce n’est pas cela dont il s’agit. Il travaille à la fois avec des scolaires, le « grand public » et des chercheurs pour les aider à communiquer entre eux : il constate tout au long de son parcours que, pour transmettre un contenu, quelle que soit l’audience à laquelle on s’adresse, les outils sont les mêmes. Et retraçant quelques-unes des étapes-clés de son parcours, il va nous révéler lesquels. Cela commence par la situation dans laquelle un chercheur s’emploie à expliquer ce sur quoi il travaille.
Pour notre hôte aujourd’hui, c’est en effet une expression plus satisfaisante pour décrire son travail que ne le sont communication, vulgarisation ou même médiation scientifique, car à ces différents termes sont souvent associés des types de publics et des motivations toutes autres. Instruire ? Divertir ? Vendre ?… Pour Renaud Chabrier, ce n’est pas cela dont il s’agit. Il travaille à la fois avec des scolaires, le « grand public » et des chercheurs pour les aider à communiquer entre eux : il constate tout au long de son parcours que, pour transmettre un contenu, quelle que soit l’audience à laquelle on s’adresse, les outils sont les mêmes. Et retraçant quelques-unes des étapes-clés de son parcours, il va nous révéler lesquels. Cela commence par la situation dans laquelle un chercheur s’emploie à expliquer ce sur quoi il travaille.
Quel niveau d’abstraction quand on raisonne ?
Discuter entre scientifiques est une entreprise périlleuse. Elle l’est tout autant entre scientifiques et publics passionnés. Car, nous dit Renaud Chabrier, la mentalité humaine montre une certaine propension à mélanger les concepts, par le truchement d’un langage sous-spécifié. En conséquence, on peut aboutir sans même le vouloir, à des raisonnements stériles et normatifs qui empêchent la progression de la réflexion scientifique et le partage des savoirs. Alors, pour lui, le dessin s’impose comme un outil privilégié pour « voyager entre les différents niveaux d’abstraction et les relier les uns aux autres ». Cela a été une clé pour comprendre le sens de sa propre pratique du dessin depuis plus de 20 ans.

« Il ne s’agit pas de montrer les images les plus spectaculaires, il faut donner du contexte. »
Mais on se rend compte que bien souvent le contexte n’est pas actualisé. En plus d’être rarement rafraîchies, les illustrations dans les travaux scientifiques – montrés ou non au public – sont souvent des images très hétérogènes, tant dans leurs contenus que par les logiques qui ont permis de les construire. Cela devient vite un problème quand il s’agit de s’entendre sur une notion précise. Et pourtant, il est évident qu’adopter un langage univoque est une condition nécessaire à la démarche et au dialogue scientifique. Sans être aussi rigoureux, le dessin offre de multiples possibilités pour naviguer d’un concept à l’autre. Par ce biais il permet de réactiver des connaissances acquises il y a longtemps comme de faire le point sur des découvertes beaucoup plus récentes.
La démarche
Ces principes de travail, très généraux, ne sont pas associés à une activité professionnelle particulière. Renaud Chabrier a dû en faire le test empirique : « Je me suis demandé ce qui se passerait si j’utilisais les moyens traditionnels, le dessin [pour diffuser des connaissances scientifiques], et quels contrats on me donnerait. C’était expérimental. Mais j’ai constaté que je pouvais en vivre. »
Et ainsi de cheminer vers son occupation actuelle, en poursuivant une recherche épistémologique. Dans les dix premières années son travail est très versé dans l’anatomie et le mouvement. Il est en contact rapproché avec le milieu du spectacle, celui de la danse surtout. En parallèle, il développe l’animation par morphing[ii], d’abord sur des œuvres artistiques. C’est une forme d’animation très fluide, qui conserve l’épaisseur et la matérialité du dessin.
« Le dessin et l’image numérique, ce n’est pas du tout la même logique. »
Une mise au point s’impose : « il faut bien garder à l’esprit que dessin animé et images de synthèse peuvent avoir une spatialité et une fluidité comparables, mais ils cachent des logiques complètement différentes. On peut les faire marcher ensemble, mais ça n’induit pas les mêmes niveaux de représentation. » On pourrait dire que l’image de synthèse, c’est une forme, sur laquelle on applique une texture, un éclairage et un point de vue de caméra. Dans le morphing, c’est une texture qui génère l’idée de forme et de point de vue.
Vidéo : http://www.renaudchabrier.com/files/videos/cachalot_timewarp_web_H264_12-5ips.mov
Du laboratoire au musée
Plus tard, Renaud Chabrier gagne un premier appel d’offres à Universcience, pour réaliser une maquette animée qui synthétise une importante découverte archéologique. Il réunit une équipe dont l’originalité est de venir du spectacle vivant, afin de mettre cette expérience au service de thèmes scientifiques. Et tout s’enchaîne : pour faire face aux projets qui se succèdent et aux nouvelles réglementations, il s’associe à Thierry Bertomeu, qui a fondé Nova Pista. D’abord réalisateur principal de la société de production, Renaud Chabrier invite ensuite d’autres membres de l’équipe à passer à la réalisation, notamment Clio Gavagni, Pascal Minet et Charlotte Arene.
De cette expérience de la production muséographique, il retient qu’il y a une vraie difficulté à aborder les thèmes les plus intéressants. « Je le vois comme une forme d’auto-censure. Par exemple, on ne peut pas parler de molécules, ou alors en les schématisant par de grosses boules qui remuent. Cette schématisation à l’extrême est très répandue, et c’est dommageable au contenu. » Il réalise également que l’organisation du système de production est régulièrement défaillante, en particulier du fait que tout est externalisé. Il est difficile de trouver des sociétés de production rigoureuses sur le plan scientifique, ayant la formation suffisante et surtout le souci de cohérence avec ce qui se fait en sciences : « On s’est souvent retrouvé à faire nettement plus que ce qui était prévu dans le cahier des charges, sans être payé plus ! Tout simplement parce que c’était nécessaire pour la narration. » Par exemple, pour l’exposition « Pasteur, l’expérimentateur » au Palais de la Découverte, la réalisation d’un théâtre optique autour de la controverse sur la génération spontanée, qui a opposé Pasteur et Pouchet, a nécessité une recherche approfondie dans les textes des années 1860. « Une société de production normalement ne va pas aussi loin. Mais on n’aurait pas pu faire dialoguer les personnages, construire notre récit, sans faire cette recherche. »
Secrets de fabrication
Il y a deux ans, deux grands thèmes d’exposition temporaire semblent évidents à notre interlocuteur : la biologie cellulaire moderne – et son implication dans les recherches sur le cancer, et les matériaux anciens qui permettent de faire entrer le public le plus large dans des sujets de physique et de chimie qui peuvent être un peu arides, mais qui, une fois intégrés dans l’histoire d’un fossile ou d’un objet particulier, deviennent passionnants pour tous. « On s’appuie sur les recherches pour construire l’histoire d’un objet. C’est ça qui m’intéresse dans le DIM. Pour moi, ça fait partie de la justification de ces études. » Et justement, s’appuyer sur des cas d’étude peut servir à ancrer la transmission scientifique dans la narration, pour en faciliter la mémorisation.

« On s’approprie mieux des connaissances quand elles sont racontées. »
Après, tout est une question de gestion de l’attention et d’organisation du récit : les études menées dans le DIM sont autant d’occasions de traiter d’une technique particulière (la tomographie pour l’étude de textiles minéralisés par exemple), mais on ne peut en montrer qu’une à la fois, du moins la plupart du temps. « On peut choisir de traiter des cas qui vont permettre aux publics d’acquérir des éléments sur lesquels ils pourront s’appuyer pour comprendre des choses plus compliquées. Il faut avancer pas à pas, ne pas donner trop d’infos à la fois, au risque de manquer des choses intéressantes. » Faire de la recherche, c’est souvent tenter de comprendre des processus, par exemple l’évolution de l’état d’un objet entre ce qu’il a été et ce qu’on observe aujourd’hui. Et c’est cela qu’il faut transmettre. Pour comprendre ce processus, il faut faire appel à un ensemble de connaissances, des sciences de la matière, des sciences sociales, de l’archéologie… Pour Renaud Chabrier, c’est la structure de ces études interdisciplinaires qu’il est intéressant d’exploiter en termes de narration. « On applique différents regards pour essayer de cerner ce qui s’est passé. » On est loin d’une simple transposition sur une surface plane.
Les projets
Renaud Chabrier est aujourd’hui dans une période de transition. Son travail évolue de plus en plus vers le scénario et la direction artistique. Mais il reste au cœur de son travail la volonté de faire comprendre la relation entre les sciences et le dessin, par tous les moyens.
On l’a bien compris, le dessin ce n’est pas l’image numérique. Le dessinateur compte aussi parmi ses priorités la rédaction d’un essai qui fasse le point sur cette question. Autre nouveau cap : la formation. « Après 25 ans de métier, mes yeux ne sont plus ce qu’ils étaient, c’est un avertissement ! De plus, on ne peut pas travailler sans assistants, qui doivent pouvoir prendre le relais à leur tour. D’où l’intérêt de former des gens. » A l’institut Curie, il trouve déjà quelques jeunes chercheurs désireux de s’ouvrir au dessin. Il y a une vraie demande, et ses stages sont très prisés.
Et la muséographie ? Notre hôte explique que la demande est forte là aussi, mais que l’orientation des crédits pose de sérieuses questions. « Avec ces budgets de production, on pourrait faire des films ou des dispositifs de référence, montrables dans les lycées. En-dehors des expos, certaines de nos productions sont susceptibles d’être diffusées avec CNRS images ou Universcience, par exemple. Mais il faudrait une coordination beaucoup plus globale. »
Quant à Nova Pista, l’objectif aujourd’hui est avant tout de trouver une manière de pérenniser son activité. Rapporté à sa taille, la société a déjà beaucoup investi. Et les relations avec les grosses structures muséales peuvent être déséquilibrées, gourmandes en temps, en compétences. Des investissements qui passent parfois par pertes et profits. À cela s’ajoutent toutes les questions relatives aux droits de diffusion, à la façon d’engager des partenariats, avec des structures de taille et de mode de fonctionnement très variés. Cela peut être aussi une contrainte forte pour les laboratoires, qui apportent un contenu gratuit, mais sur lesquels pèse une responsabilité de rendu, de fiabilité, lourde et difficile à gérer. Bien sûr, il est possible de travailler avec de « petits » musées, mais les budgets y sont aussi plus réduits. C’est un élément qui peut nourrir la réflexion pour le DIM.
Avec le DIM
 Même s’il a trop de travail pour le moment pour initier de nouveaux projets, il peut s’investir dans les activités du DIM via son expérience et son réseau. « De par ma position de dessinateur, je suis en contact avec des milieux très différents. Je peux voir des thèmes à connecter, des façons de faire complémentaires. » Et Nova Pista peut aussi monter des équipes au besoin.
Même s’il a trop de travail pour le moment pour initier de nouveaux projets, il peut s’investir dans les activités du DIM via son expérience et son réseau. « De par ma position de dessinateur, je suis en contact avec des milieux très différents. Je peux voir des thèmes à connecter, des façons de faire complémentaires. » Et Nova Pista peut aussi monter des équipes au besoin.
Renaud Chabrier établit un parallèle entre les préoccupations du DIM et celles de l’Institut Curie : « il y a la même volonté de se réapproprier une capacité de transmission vers le grand public. »
Cependant, même s’il constate qu’il y a une vraie envie d’aller plus loin, il sait aussi que produire des outils de transmission à partir de la recherche n’est pas encore une évidence. Les productions qui en sont issues ne sont pas nécessairement relayées par les antennes de diffusion classique. In fine, c’est toujours au même endroit que le bât blesse : est-il possible d’organiser un projet si la collaboration avec les chercheurs n’est pas coordonnée et si la diffusion n’est pas structurée ? Car une société de production, même associative, a besoin de monter une équipe, et donc potentiellement d’embaucher. Et une question de budget peut aussi conditionner son implication dans les activités d’un réseau comme le DIM.
Travailler avec des chercheurs
Mais au juste, qu’est-ce que les chercheurs y gagnent vraiment ?
Parfois, quand l’envie de transmission vient des chercheurs, ceux-ci peuvent vouloir trop en dire. D’autres fois, il y a plutôt une volonté de laisser l’équipe de production découvrir le sujet par elle-même : sur certains projets, « [les chercheurs] ne nous facilitent pas la tâche ! Je pense que c’est pour nous faire nous placer dans une proposition complémentaire à la leur, adopter un angle à nous. » Il arrive même que la communication soit difficile entre équipe de recherche et équipe de production. Mais tout le monde finit par y trouver son compte. Renaud Chabrier raconte l’un des derniers chantiers sur lequel il s’est engagé : « Ça les a forcés à dialoguer entre eux, à expliciter la finalité de l’étude. Quand on entre un peu dans les détails, passé le stade des schémas, c’est là que le travail intéressant commence. »
Quant à la valorisation du résultat, cela peut s’exprimer de différentes manières. A l’institut Curie, les images de Renaud Chabrier ont servi pendant 10 ans, faisant référence et servant d’appui au dialogue entre chercheurs : « ça a contribué à souder l’équipe. Le film sur l’amulette de Mehrgarh que nous avons fait avec IPANEMA[iii] a un rôle similaire. C’est une porte d’entrée. »
Il constate en général une attente d’accompagnement certaine. Ce qui n’est pas sans biais d’ailleurs, jusqu’à devenir l’attente d’une approche de sciences sociales. Le contexte n’est pourtant pas le même : « une résidence pour observer la recherche en train de se faire, ça demande beaucoup de présence et de moyens. On bute tout de suite sur des problèmes concrets, l’éloignement du site par exemple. » On mesure alors bien la différence d’économie et de temporalité : « la collaboration n’est pas facile à mettre en place parce que dans la production, on est dans une situation telle que si ça s’étale dans le temps, on perd de l’argent. »
Alors, le problème mérite qu’on en parle franchement, car selon lui, ce sont des difficultés qui peuvent et doivent être levées. « Avec une bonne organisation, on pourrait produire un genre de films plus exigeants que ce qu’on trouve dans les expositions actuelles. » Et cela préfigure ce que pourraient être les futurs modes de diffusion. « C’est peut-être notre investissement le plus fort dans le DIM : comprendre comment ça pourrait marcher. »
[i] Alfred A. S. Korzybski, Science and Sanity, https://web.archive.org/web/20040205124242/http://www.esgs.org/uk/art/sands.htm
[ii] Voir quelques-uns des travaux de Renaud Chabrier sur son site internet : www.renaudchabrier.com et sur sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCprj4h84AfocIl73miS-Akg
[iii] https://lejournal.cnrs.fr/videos/le-mystere-de-lamulette